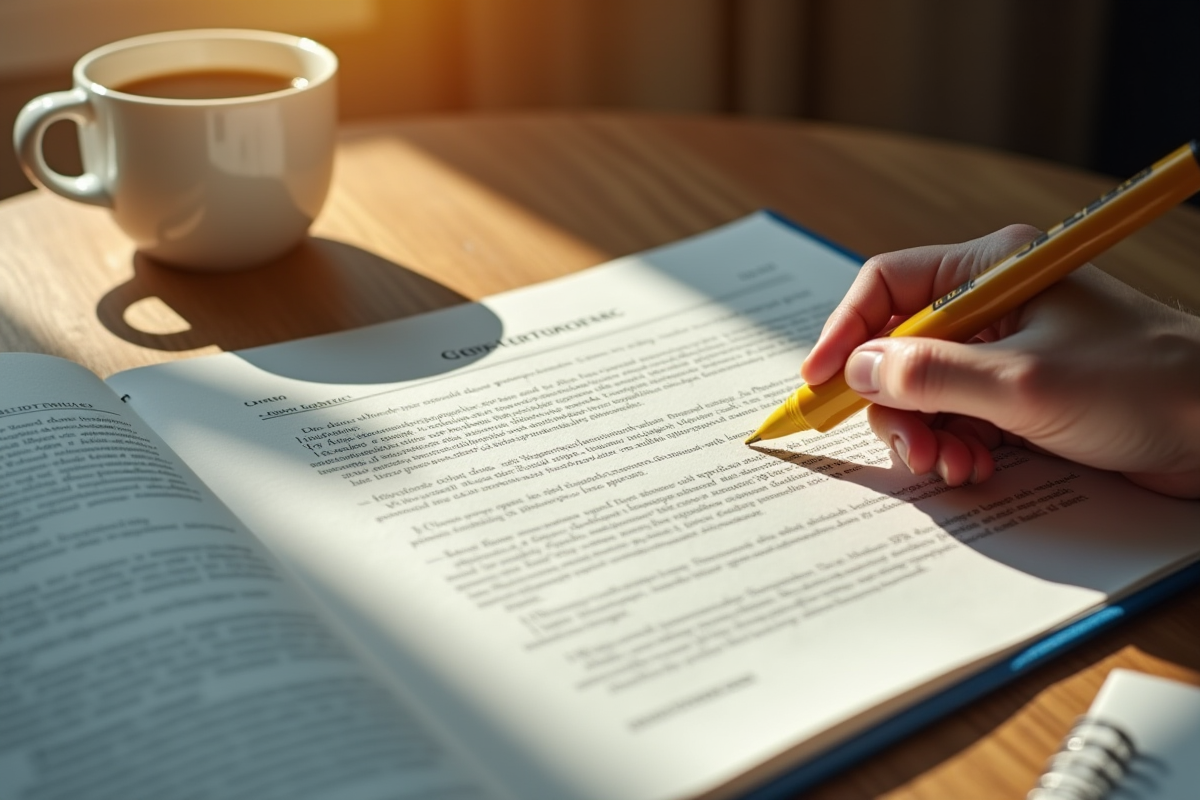Un employeur qui passe à côté de l’évaluation des risques sur son lieu de travail s’expose désormais à des sanctions administratives immédiates. Certaines sociétés, jusque-là épargnées par certaines exigences, doivent aujourd’hui revoir de fond en comble leurs procédures internes pour rester dans les clous de la réglementation. Des règles renforcées s’imposent sur la prévention, la déclaration d’accidents et la participation active des salariés à la gestion de la santé et de la sécurité. Ces nouveautés concernent autant les grandes entreprises que les petites structures, forçant un ajustement concret des pratiques au quotidien.
La loi 59 en bref : ce qui change pour la santé et la sécurité au travail
Le projet de loi n°59 bouleverse le terrain de la santé et sécurité au travail au Québec. Fini les arrangements à la marge : la protection des travailleurs devient une exigence qui ne tolère plus l’improvisation. Cette réforme rebat les cartes de la LSST (Loi sur la santé et la sécurité du travail) et de la LATMP (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles). Plus personne n’y échappe : qu’on dirige une PME ou un grand groupe, il faut désormais documenter la gestion des risques, investir dans la prévention concrète et piloter le suivi au quotidien, sans relâche.
La CNESST dispose à présent de leviers puissants pour faire respecter ces obligations. Les employeurs sont sommés de prendre au sérieux les risques psychosociaux et la violence en milieu de travail, selon les recommandations de l’INSPQ. Afficher des consignes ne suffit plus : la prévention se traduit désormais par des actes, ancrés dans la réalité des équipes et du management.
Pour y voir plus clair, voici ce que la réforme change concrètement :
- La participation des salariés prend un nouveau visage : des sièges supplémentaires en comité, nomination de représentants dédiés, dialogue renforcé avec la direction.
- Les démarches pour déclarer un accident ou une maladie professionnelle sont allégées et accélérées, ce qui favorise la transparence et la réactivité.
- Formations et accès à l’information deviennent un point de vigilance constant, la CNESST surveillant de près la qualité des pratiques internes.
En s’alignant sur les standards internationaux, le Québec invite chaque acteur à renforcer son analyse des situations de travail et à faire de la prévention un pilier central de la stratégie d’entreprise. Avec la loi 59, il ne s’agit plus d’ajuster quelques clauses : c’est toute l’architecture de la santé et de la sécurité qui est repensée, dans tous les secteurs d’activité.
Quels sont les enjeux majeurs pour les entreprises et les salariés ?
La gestion des risques professionnels change de dimension. Les angles morts disparaissent : chaque employeur doit aujourd’hui cartographier les risques psychosociaux et la violence au travail, surveiller et intervenir sans attendre. Impossible de tout remettre entre les mains d’un service unique : la direction générale porte désormais la responsabilité, bien au-delà du service RH ou QHSE.
Les comités de santé et de sécurité (CSE, CSSCT) s’imposent comme la cheville ouvrière des politiques de prévention. Leur champ d’action s’élargit : ils définissent, réajustent et pilotent les plans d’action. Les salariés, davantage sollicités, deviennent de véritables sentinelles pour détecter les signaux faibles et les situations à risque. Ce dialogue direct offre une photographie fidèle du terrain.
Voici les dispositifs qui s’installent progressivement dans la vie des employeurs :
- Programme de prévention : chaque entreprise adapte ses mesures à sa réalité et actualise ses procédures périodiquement.
- Désignation de représentants en santé et sécurité : cette obligation concerne désormais aussi les PME, plus seulement les grands comptes.
- Accompagnement par un service de prévention et de santé au travail : médecins et infirmiers spécialisés interviennent plus tôt, pour anticiper, repérer et guider les dirigeants dans leurs décisions.
Côté salariés, la protection gagne du terrain, notamment lors de réorganisations ou de changements fréquents. Le service de prévention et de santé au travail agit plus en amont, suit les équipes sur la durée, intervient directement sur place. Les employeurs, quant à eux, doivent intégrer de nouvelles exigences et instaurer une traçabilité qui sert de base à toutes leurs démarches.
Obligations, droits et responsabilités : décryptage des nouvelles règles à connaître
Le contrat de travail ne ressemble plus à celui d’hier. Depuis le 30 juin 2025, toute marque de discrimination liée à la parentalité, qu’il s’agisse de PMA ou d’adoption, doit disparaître du parcours professionnel. Les employeurs sont tenus de réviser leurs politiques internes pour garantir l’égalité à chaque étape du parcours : recrutement, évolution, départ.
Les autorisations d’absence pour PMA ou adoption se généralisent : elles sont rémunérées, incluses dans le temps de travail et strictement protégées sur le plan de la confidentialité. Le médecin du travail peut consulter le dossier médical partagé, mais seulement avec l’accord explicite du salarié. Le secret médical demeure inviolable.
Pour mesurer concrètement ces avancées, voici les droits consolidés pour les salariés :
- Droit à l’absence : toute personne engagée dans une démarche de PMA ou d’adoption peut s’absenter sans perte de salaire.
- Confidentialité : les données sensibles sont protégées ; seules celles strictement nécessaires sont consultables.
- Égalité de traitement : aucune différence de traitement n’est admise en raison de la parentalité, que ce soit à l’embauche, pendant l’emploi ou lors d’une rupture.
Le service de prévention et de santé au travail, composé de professionnels aguerris, joue un rôle de conseil et de médiation en cas de difficulté. Pour l’employeur, instaurer un climat de confiance devient une exigence quotidienne. Impossible de viser la performance sans dialogue ni équité réelle.
Adopter les bons réflexes pour une mise en conformité sereine
Réussir la mise en conformité repose sur l’anticipation, l’organisation et le choix d’outils adaptés. Les processus internes évoluent, le numérique prend sa place et de nouveaux réflexes s’installent. La signature électronique, reconnue par le code civil et le règlement eIDAS, devient un pilier de la gestion documentaire : elle identifie sans ambiguïté le signataire, assure l’intégrité du document, et coupe court à toute contestation. Selon le dossier, il existe plusieurs niveaux : signature simple, avancée ou qualifiée. Qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’un avenant ou d’une attestation d’absence pour la PMA, la signature avancée délivrée par un tiers de confiance s’impose de plus en plus comme la référence. Certaines entreprises intègrent ces solutions à leur système d’information, d’autres s’appuient sur les dispositifs nationaux d’identification pour faciliter la transition.
Pour organiser cette mutation, quelques étapes structurent la démarche :
- Identifiez les processus où la signature électronique s’impose, pour couvrir tous les besoins réels.
- Passez en revue les solutions, en vérifiant leur conformité technique et leur simplicité d’utilisation.
- Formez tous les collaborateurs, managers compris, car l’appropriation collective reste le moteur d’une adoption maîtrisée.
La traçabilité devient la règle : chaque validation, chaque action laisse une empreinte numérique accessible, qui protège toutes les parties prenantes. En s’appuyant sur des ressources compétentes, qu’il s’agisse des équipes RH ou de conseils extérieurs, les entreprises abordent ces évolutions réglementaires avec un atout de stabilité et de réactivité.
La loi 59 exige une vigilance continue et une prévention incarnée, jour après jour. Reste à observer qui saura transformer cette contrainte en moteur collectif et jusqu’où cette dynamique réussira à installer, pour de bon, la confiance au centre du jeu.